Valeur pH dans les soins de la peau
pH
L’échelle de pH va de 0 à 14 et exprime l’acidité ou l’alcalinité d’une substance (généralement une solution aqueuse). Une solution dont le pH est de 7,0 est dite neutre, tandis qu’une solution dont le pH est inférieur est acide et qu’une solution dont le pH est supérieur est basique ou alcaline. Plus le pH est bas, plus la solution est acide, et plus il est élevé, plus celle-ci est alcaline.
Le pH est un terme très important dans de nombreux contextes, car l’acidité d’une solution a un impact majeur sur les processus chimiques et biochimiques qui peuvent avoir lieu dans la solution. Ainsi, la régulation de la valeur du pH d’une solution a également son importance dans de nombreux contextes. La « capacité tampon » apparaît aussi comme un terme important (on parle aussi de « pouvoir tampon ») : La capacité tampon est la mesure du potentiel d’une solution à maintenir son pH lorsqu’on ajoute une base ou un acide.
Le pH et la capacité tampon sont importants dans de nombreuses industries (qui impliquent presque toutes l’eau), mais aussi pour l’homme : le corps humain dépend entièrement de sa capacité à réguler et à maintenir le pH dans ses tissus pour que les processus biochimiques appropriés puissent se dérouler. Par exemple, le pH du sang est très étroitement régulé de sorte que, dans des conditions normales, il se situe entre 7,35 et 7,45. Le sang possède une capacité tampon assez élevée grâce aux substances qu’il contient. En outre, les poumons et les reins contribuent à maintenir le pH du sang en régulant l’élimination de certaines substances. Des affections telles que le diabète, ainsi que les maladies pulmonaires et rénales, peuvent entraîner un excès d’acide dans le sang, provoquant une baisse du pH en dessous de 7,35 – c’est ce qu’on appelle « l’acidose », tandis que l’hyperventilation, par exemple, peut augmenter le pH du sang – c’est ce qu’on appelle « l’alcalose ». Les autres tissus de l’organisme dépendent également d’un pH adéquat, qui peut être affecté par certaines maladies : par exemple, des poumons sains ont un pH autour du neutre, mais dans le cas de la mucoviscidose, le pH des poumons chute. Le pH à la surface de la peau se situe normalement du côté acide, mais il varie beaucoup en fonction, notamment, de l’endroit du corps et du degré d’inflammation de la peau. En général, un pH plus élevé est observé en cas d’inflammation et dans les zones où la peau est plus refermée sur elle-même, comme l’aisselle. Comme pour d’autres tissus, les processus biochimiques de la peau et le microbiote dépendent de la valeur du pH de la zone.
Le pH est donc un sujet intéressant dans le domaine des cosmétiques et auquel PUCA PURE & CARE accorde une grande attention lors du développement de ses produits.
Le pH : une invention danoise
Le concept de pH a été inventé par le professeur de chimie danois Søren. P. L. Sørensen en 1909, alors qu’il dirigeait le département chimie du laboratoire Carlsberg. Søren. P. L. Sørensen a utilisé la désignation « pH. » qui a ensuite été changée en 1924 en « pH » dans le cadre d’une révision mineure du concept.
Jusqu’en 1909, la science utilisait principalement des termes vagues concernant l’acidité d’une solution, ce qui n’était pas assez précis pour Søren. P. L. Sørensen dans son travail sur le brassage de la bière, où il s’intéressait particulièrement aux processus enzymatiques. Il avait besoin d’un outil précis pour standardiser la production de bière. À cette époque, on savait que c’était la concentration d’ions H+(ions hydrogène) dans une solution qui déterminait le degré d’acidité de la solution, mais spécifier la concentration en nombres décimaux n’était pas une bonne solution, car il s’agit de très petits nombres.
La solution était l’échelle de pH, qui est le logarithme décimal négatif de la concentration des ions d’hydrogène, ce qui peut s’écrire simplement : pH = -log([H+]). Le concept et la définition seront examinés plus en détail dans la section suivante. Le sigle « pH » lui-même a fait l’objet de spéculations. Il ne fait aucun doute que le « H » signifie hydrogène (ion), mais le « p » est plus controversé, car il peut représenter des mots différents (avec des significations similaires) en français, danois, allemand, qui étaient les langues dans lesquelles Søren. P. L. Sørensen rédigeait ses articles, ainsi que le latin, également largement utilisé dans la littérature scientifique. En danois, le « p » peut signifier « potens » ou « potentiale », en allemand « potenz », en français « puissance », et enfin en latin « pH » peut signifier « pondus hydrogenii » (quantité d’hydrogène) ou « potentia hydrogenii » (puissance/potentiel d’hydrogène). Toutefois, si l’on consulte l’article original de 1909, il semble que « p » soit simplement la lettre que Sørensen avait donnée à la composition de son électrode à hydrogène, alors qu’il utilisait « q » pour la composition de son électrode de référence.
Aujourd’hui, la désignation « p » minuscule est utilisée en chimie pour « le logarithme décimal négatif de… » et aussi, par exemple, dans la désignation « pKa», qui sera abordée dans la section suivante.
L’utilisation de l’échelle de pH s’est rapidement généralisée et était couramment utilisée dans les articles scientifiques à peine dix ans après son invention. De nos jours, le pH est utilisé partout où l’acidité est pertinente, c’est-à-dire dans de nombreux domaines.
Par exemple, dans la production d’aliments, de médicaments, de cosmétiques, de papier, de textiles et dans l’agriculture, dans la gestion des eaux usées et dans de nombreuses études scientifiques en général.
Les processus biochimiques propres à l’organisme dépendent généralement d’un pH assez spécifique. C’est pourquoi chaque fluide corporel, comme le sang, le liquide céphalorachidien, l’urine et les fluides contenus dans les organites de chaque cellule. Les processus biochimiques propres à l’organisme dépendent généralement d’un pH assez spécifique. C’est pourquoi chaque fluide corporel, comme le sang, le liquide céphalorachidien, l’urine et les fluides contenus dans les organites de chaque cellule1 sont étroitement régulés et dotés d’une capacité tampon, de sorte que le pH est maintenu malgré les influences extérieures.
Exemples de valeurs de pH de différentes solutions : Acide gastrique : 1,5-3,5 ; jus de citron : 2,4 ; vagin : 3,8-4,5 ; peau : 4,1-5,8 (peau non endommagée, malade ou occluse) ; lait : 6,5 ; eau pure : 7,0 (pH neutre à 25 °C) ; sang : 7,35-7,45 ; urine : 7,5-8,0 (l’urine du matin est généralement plus acide : 6,5-7,0) ; eau de mer : 7,5-8,4 ; savon solide classique : 9,0-10,0 ; une solution aqueuse d’hydroxyde de sodium de concentration molaire 0,1 (environ 4 %) : 13,0.
1Les organites sont les structures internes (« organes ») de la cellule qui sont délimitées par une membrane et qui remplissent différentes fonctions. Quelques exemples d’organites sont le noyau cellulaire, qui contient l’ADN (le pH à l’intérieur est de 7,1-7,3) et les mitochondries, qui produisent la majeure partie de l’énergie de la cellule (ATP) (le pH dans les mitochondries humaines est respectivement de 7,8-8,0 dans la matrice et de 7,0-7,4 dans l’espace entre les membranes externe et interne).
Le pH : quelques mots sur la science et la technologie qui
le sous-tendent
Comme indiqué, le pH d’une solution est une mesure du degré d’acidité ou d’alcalinité – et plus spécifiquement le logarithme décimal négatif de la concentration de la solution ou, plus précisément l’activité (a)2 des ions hydrogène (H+). Celui-ci s’écrit comme suit :
pH = -log(aH) ≈ -log([H+])
Le terme H+ (ion hydrogène) est le plus utilisé, mais en réalité, il n’y a pas d’ions H+libres dans une solution aqueuse, car les ions H+réagissent avec l’eau H2O pour former H3O+, que l’on appelle ion hydronium ou oxonium.
L’échelle de pH va de 0 à 143 et comme le pH est logarithmique (le logarithme décimal), la valeur n’a pas d’unité et chaque valeur de pH représente une différence d’un facteur 10 dans la concentration d’ions H+. Ainsi, une solution avec un pH 5,0 aura une concentration dix fois plus élevée d’ions H+qu’une solution de pH 6,0.
De même que les ions H+ définissent le niveau d’acidité, les ions OH- (ion hydroxyde) définissent le niveau d’alcalinité4 : l’équilibre entre ces deux ions est crucial pour le pH de la solution aqueuse. Un pH bas indique une concentration relativement élevée de H+ et une faible concentration de OH-. Lorsque le pH augmente, la concentration de H+ diminue et la concentration de OH- augmente. À un pH 7.0, la concentration de ces ions est égale (c’est le cas de l’eau totalement pure), et à un pH supérieur à 7,0 la concentration de OH- dépasse la concentration de H+.
Pour comprendre d’où viennent H+ et OH- , il faut comprendre comment fonctionnent les acides et les bases. En résumé, un acide est une substance qui peut libérer un (ou plusieurs) ion(s) hydrogène, tandis qu’une base est une substance qui peut absorber un (ou plusieurs) ion(s) hydrogène.
La facilité avec laquelle l’acide libère son hydrogène est une mesure de la force de l’acide : plus il libère facilement l’hydrogène, plus il est fort. Il en va de même pour la base : plus elle absorbe facilement l’hydrogène, plus elle est forte.
La réaction par laquelle un acide libère de l’hydrogène (H+) est appelée réaction de dissociation et se présente comme suit :
HA ⇌ H+ + A-
Où HA désigne l’acide, H+ est l’ion hydrogène libéré, A- désigne la base dite correspondante (le résidu acide) et ⇌ indique qu’il s’agit d’une réaction qui peut aller dans les deux sens.
Il s’agit donc d’une paire acide-base. Pour de telles paires acide-base, la base correspondante d’un acide fort est relativement faible et, de même, l’acide correspondant d’une base forte est relativement faible, tandis que la base correspondante d’un acide faible est également relativement faible et, de même, la base faible a un acide faible correspondant.
Ainsi, une solution d’un acide (ou d’une base) sera un équilibre entre la forme acide (HA) et la dissociation en H+ et la base correspondante, A5.
. Ce rapport d’équilibre entre la concentration de la forme dissociée (H+ et A-) et la forme acide (HA) est une valeur sans unité, appelée constante de dissociation de l’acide et notée Ka6. Ka augmente parallèlement avec la force de l’acide.
2La concentration d’ions hydrogène [H+] est normalement le terme utilisé pour décrire le pH, mais de façon plus exacte, c’est l’activité des ions H+ . Dans la pratique, c’est quasiment la même chose.
3Dans les cas particuliers de forte concentration d’acides très forts ou de bases très fortes, le pH peut être inférieur à 0 et supérieur à 14.
4Tout comme le pH, il existe également une mesure moins couramment utilisée, le pOH, qui correspond au logarithme négatif de la concentration en ions OH-, exprimant le niveau acide ou basique de la solution.
5Il s’agit d’une réaction qui dépend de la température et qui constitue en soi un système tampon faible (de faible capacité).
6Les autres termes désignant la constante de dissociation sont la constante d’équilibre et la constante de force de l’acide. Le « a » minuscule de Ka signifie « acide » ; il arrive que l’on trouve parfois la désignation « Ks» dans la littérature scientifique danoise, où « s » est pour « syre » (acide).
La force de l'acide
Comme pour le pH, cette valeur est généralement convertie en pKaplus « gérable » et également sans unité. Cette valeur est appelée exposant de la force de l’acide et, comme pour le pH, se définit comme le logarithme décimal négatif de la constance de la force de l’acide :
pKa = -log(Ka)
La valeur pKapeut servir à diviser les acides en acides forts, moyens, faibles et très faibles comme suit :
- pKa ≤ 0 : acide fort
- 0 < pKa ≤ 4 : acide moyen
- 4 < pKa ≤ 10 : acide faible
- pKa > 10 : acide très faible
Pour un acide faible dans une solution aqueuse, la plupart des molécules seront sous forme acide (HA). Inversement, une solution avec un acide fort contiendra principalement la forme dissociée (H+ et A-et donc la concentration de H+ sera élevée dans la solution et le pH sera faible.
La molécule d’eau elle-même est un ampholyte, ce qui signifie qu’elle est à la fois un acide très faible et une base très faible : son pKa est de 7,0. La réaction acide-base pour l’eau se présente comme suit : deux molécules d’eau réagissent pour libérer et recevoir un ion H+, mais la réaction peut également se produire dans l’autre sens :
2 H20 ⇌ H3O+ + OH-
Comme il s’agit d’un acide très faible et d’une base très faible, seule une très petite partie sera dissociée en H3O+ et OH-. Lorsque l’eau est totalement pure, 10-7 (= 0,0000001 = un dix millionième) des molécules de H2O seront dissociées, ce qui permet d’obtenir un pH neutre de 7 :
pH = -log (10-7) = 7
La relation entre pH et pKa est exprimée par l’équation de Henderson-Hasselbalch, aussi appelée équation du système tampon. Cette équation est une approximation et contient quelques hypothèses. Elle n’est pas aussi précise pour les acides et les bases fortes et ne tient pas compte des propriétés acido-basiques propres à l’eau. L’équation de Henderson-Hasselbalch est la suivante :
pH = pKa + log [A-]/[HA]
Elle démontre que le pH d’une solution acide (ou basique) est égal au pKa de l’acide additionné du logarithme de la concentration de la base correspondante divisé par la concentration de l’acide. Si la concentration de la base correspondante et la concentration de l’acide sont égales, le pH de la solution sera égal au pKade l’acide. Cette équation est également connue sous le nom d’équation du système tampon, car elle est principalement utilisée pour calculer les systèmes tampons. Par exemple, on peut utiliser l’équation pour estimer le pH d’un système tampon et pour calculer la concentration de l’acide et de la base correspondante si l’on connaît le pH et le pKa.
Systémes tampons
Elle démontre que le pH d’une solution acide (ou basique) est égal au pKa de l’acide additionné du logarithme de la concentration de la base correspondante divisé par la concentration de l’acide.
Si la concentration de la base correspondante et la concentration de l’acide sont égales, le pH de la solution sera égal au pKade l’acide. Cette équation est également connue sous le nom d’équation du système tampon, car elle est principalement utilisée pour calculer les systèmes tampons. Par exemple, on peut utiliser l’équation pour estimer le pH d’un système tampon et pour calculer la concentration de l’acide et de la base correspondante si l’on connaît le pH et le pKa.
Un système tampon se compose d’un acide (généralement relativement faible) et de sa base correspondante (ou d’une base relativement faible et de son acide correspondant) et est utilisé pour maintenir le pH dans une plage relativement étroite malgré l’ajout d’acide ou de base au système : ainsi, un système tampon agit comme un « tampon pH » avec une certaine capacité. La capacité représente la quantité d’acide ou de base qui peut être ajoutée au système sans modifier le pH de manière significative. Elle dépend principalement de la concentration de l’acide et de la base correspondante, ainsi que du pH de la solution. La capacité est à son maximum lorsque la concentration de l’acide et de la base correspondante est proche de l’égalité et lorsque le pH de la solution est proche de la valeur pKade l’acide – généralement, la capacité est maximale dans la plage pH-pKa ± 1.
Les systèmes tampons fonctionnent en ce sens que l’acide faible et la base correspondante peuvent réagir avec l’acide (H+et/ou la base (OH-) ajoutés et ainsi « neutraliser » le H+ ou la OH-, de sorte que le pH ne change pas beaucoup. Lorsque vous dépassez la capacité, par exemple en ajoutant une quantité d’acide telle que la totalité de la base correspondante dans la solution est épuisée par la réaction avec l’acide ajouté, le pH chute assez brusquement. Inversement, si vous ajoutez plus de base que la capacité du système tampon ne peut en supporter (parce que l’acide dans le système tampon est épuisé), le pH augmente assez brusquement.
En pratique, on crée normalement un système tampon en ajoutant un acide (ou une base) dont le pKa est adapté au pH souhaité, et en ajoutant une quantité équivalente de la base correspondante sous la forme du sel de l’acide (ou si l’on a une base, on ajoute la quantité équivalente de l’acide correspondant).
Systèmes tampons en pratique
L’acide acétique et l’acétate de sodium (sel de sodium de l’acide acétique) constituent un exemple de système tampon (une paire acide-base). L’acide acétique a un pKa de 4,7 et son pouvoir tampon est donc le plus élevé dans la plage de pH 3,7-5,7.
Dans les cosmétiques, par exemple, on utilise souvent l’acide citrique, qui est un acide trivalent (qui peut libérer trois atomes d’hydrogène) et qui a donc trois valeurs de pKa: 3,1, 4,8 et 6,4, ce qui couvre une gamme de pH relativement large et pertinente d’un point de vue cosmétique.
7Le pH peut également être mesuré sur des substances non aqueuses, mais c’est un peu différent.
8Vous pouvez en savoir plus sur ces sujets techniques dans ces articles, par exemple : Buck, R. et. al. Measurement of pH. Definition, standards, and procedures (IUPAC Recommendations 2002). Pure and Applied Chemistry, 2002, 74(11), 2169-2200 et Zulkarnay, Z et. al. An Overview on pH Measurement Technique and Application in Biomedical and Industrial Process. 2015, 2nd International Conference on Biomedical Engineering (ICoBE), Penang, Malaysia, March 2015, pp. 1-6.
La mesure du pH des solutions aqueuses7 peut être effectuée à l’aide de différentes méthodes. Ces méthodes peuvent donner de légères différences dans la valeur et il convient donc de prêter attention à la méthode de mesure lorsque l’on compare les valeurs de pH. Les détails plus techniques de la mesure du pH et les incertitudes dont il faut tenir compte avec les différentes méthodes de mesure et les formules mathématiques qui les sous-tendent ne seront pas abordés en profondeur ici8.
L’une des méthodes les moins précises, que beaucoup connaissent peut-être depuis l’école, est la mesure du pH à l’aide d’un indicateur acide-base. Il peut s’agir d’un liquide indicateur ou d’un papier indicateur (bandelettes pH) imprégné de liquide indicateur. Ces derniers changent de couleur en fonction du pH du liquide avec lequel ils entrent en contact. Le pH peut donc être lu visuellement en le comparant à une échelle de couleurs ou, plus précisément, par colorimétrie (mesure quantitative de la couleur).
Aujourd’hui, on utilise souvent un pH-mètre, un instrument électronique doté d’une électrode de verre sélective des ions et d’une électrode de référence que l’on plonge dans la solution à mesurer. Au contact d’une solution aqueuse, un potentiel électrique se forme à travers l’électrode sensible aux ions, qui dépend de la concentration en ions hydrogène et donc du pH. Le potentiel de l’électrode de référence ne varie pas et est fixé par l’étalonnage préalable du pH-mètre, ce qui permet à l’appareil d’effectuer une comparaison quantitative entre les potentiels électriques des deux électrodes et de calculer le pH.
Il est important d’étalonner régulièrement un pH-mètre pour s’assurer que les mesures sont exactes. Il n’est pas nécessaire de disposer d’une grande quantité d’eau pour mesurer le pH, de sorte que le pH de surfaces telles que la peau peut également être mesuré avec, par exemple, un pH-mètre doté d’une électrode plate (et éventuellement d’un peu d’eau pure). Toutefois, comme ces électrodes sont relativement grandes, le pH est mesuré sur une certaine surface et il n’est pas possible de mesurer les différences de pH au niveau cellulaire ou subcellulaire. D’autres méthodes plus complexes, telles que la microscopie en temps de vie de fluorescence (FLIM), doivent être utilisées.

Le pH et la peau : structure et composants de la peau
Avant d’aborder la question du pH de la peau, il est utile de bien comprendre la structure de la peau. Il s’agit d’un sujet intrinsèquement complexe qui peut être abordé sous de nombreux angles différents. Nous nous intéresserons tout d’abord à la structure de base des couches de la peau – principalement l’épiderme – puis aux composants censés influencer le pH de la peau.
La peau se compose de trois couches9: Au plus profond se trouve le subcutis, également appelé hypoderme, qui se compose principalement de graisse et de tissu conjonctif.
Au milieu se trouve le derme, qui est principalement constitué de tissu conjonctif et dans lequel se trouvent, par exemple, des terminaisons nerveuses, des vaisseaux sanguins, des follicules pileux, des glandes sébacées et des glandes sudoripares.
La couche supérieure est l’épiderme, qui se compose de plusieurs couches. la couche la plus profonde, la couche basale, qui est une couche cellulaire simple où se trouvent notamment les mélanocytes, les kératinocytes indifférenciés et les cellules souches qui créent constamment de nouveaux kératinocytes (cellules).
Ces kératinocytes migrent vers l’extérieur et créent progressivement les autres couches épidermiques, qui sont : le stratum spinosum, le stratum granulosum, le stratum lucidum et enfin à la surface se trouve le stratum corneum (SC), qui a une épaisseur d’environ 10-30 µm.
La couche basale, la couche épineuse et la couche granuleuse contiennent des cellules vivantes et sont appelées la partie viable de l’épiderme, tandis que la couche claire10 et la couche cornée sont constituées de cellules mortes et sont appelées la partie non viable de l’épiderme – mais il se déroule de nombreux processus chimiques différents dans ces couches.
Il est important de savoir qu’il existe dans la peau de nombreuses voies de communication et interactions différentes entre les kératinocytes, les cellules immunitaires et les micro-organismes présents sur la peau, qui peuvent affecter différentes fonctions de la peau telles que le maintien des barrières cutanées.
En ce qui concerne la barrière cutanée et le pH de la peau, la couche externe de l’épiderme, la couche cornée, est particulièrement intéressante.
La couche cornée contient plusieurs couches (généralement 15 à 25) de kératinocytes plats, morts pour la plupart, appelés cornéocytes. Ceux-ci sont intégrés dans une matrice intercellulaire riche en lipides hautement organisés, qui constitue un élément crucial de la barrière cutanée. Cette structure de la couche cornée est souvent décrite comme une maçonnerie de briques (cornéocytes) et de mortier (structure lipidique intercellulaire). La couche cornée se débarrasse constamment d’une partie de sa surface pour renouveler la peau. Ce processus, appelé « desquamation », est généralement bien régulé.
9Vous trouverez une illustration de la peau dans la description de la glycérine sur ce site.
10La couche claire ne se trouve généralement que dans les peaux à épiderme épais (comme la paume des mains et la plante des pieds) et se compose de 2 à 5 couches cellulaires de kératinocytes plats, principalement morts, contenant la substance éléidine, qui est un précurseur de la kératine.
11Ils sont également appelés lipides extracellulaires.
En surface, la peau est « peuplée » de divers micro-organismes – le microbiote cutané – qui, à bien des égards, se révèlent très intéressants en ce qui concerne les fonctions et les qualités de la peau.
Les cornéocytes de la couche cornée sont des cellules plates qui contiennent principalement des filaments de kératine, diverses enzymes et de l’eau. Les cornéocytes sont entourés d’une enveloppe cellulaire spéciale appelée enveloppe cornifiée, qui se compose principalement de protéines réticulées telles que la filaggrine, la loricrine et l’involucrine, qui forment ensemble une structure hautement insoluble et stable. Une seule couche de lipides, composée principalement de céramides à longue chaîne, est attachée à ces protéines : c’est l’enveloppe lipidique.
Cette couche forme des interactions importantes avec la couche lipidique intercellulaire entre les cornéocytes.
Quelques autres structures importantes entre les cornéocytes sont les cornéodesmosomes, qui sont constitués de diverses protéines et qui maintiennent les cellules de la couche cornée ensemble, et les jonctions dites serrées, qui sont également constituées de protéines et contribuent à la fonction de barrière.
Les lipides intercellulaires11 représentent environ 15 % du poids de la couche cornée et se composent principalement de céramides (environ 50 %), de cholestérol (25-30 %), d’acides gras libres (10-15 %), d’esters de cholestérol (environ 10 %), de sulfate de cholestérol (2-5 %) et de très peu de phospholipides, ce qui contraste avec les autres couches de l’épiderme et du derme où les phospholipides représentent une part importante des lipides.
La principale source de ces lipides intercellulaires est constituée par ce que l’on appelle les « corps lamellaires », qui sont des organites sécrétoires ovales situés intracellulairement dans les kératinocytes viables, principalement dans la couche granuleuse, et qui peuvent excréter des lipides, par exemple, hors de la cellule.
Outre l’excrétion de lipides tels que les phospholipides, les glucosylcéramides et le cholestérol qui viennent former la matrice intercellulaire riche en lipides bien organisée, ces corps lamellaires excrètent également certaines enzymes telles que les hydrolases lipidiques, les lipases, les protéases et certaines protéines inhibitrices d’enzymes, ainsi que des peptides antimicrobiens tels que les bêta-défensines et les cathélicindines.
Ces organites sont donc extrêmement importants pour la barrière de perméabilité et la barrière microbienne de la peau.
Le pH et la peau : pH faible à la surface de la peau
Au-dessus des couches d’environ 10 à 30 µm d’épaisseur de la couche cornée, le pH passe de 7,0 à 7,4 comme dans le reste de la peau à un pH beaucoup plus faible à la surface, qui varie quelque peu entre les différentes parties du corps, mais le plus souvent le pH est d’environ 5,0 à la surface de la peau. Il s’agit d’une très grande différence de pH de 2 unités (c’est-à-dire environ 100 fois la concentration de H+ à la surface par rapport à environ 10-30 µm plus profondément dans la peau. Ce gradient a été étudié sur une peau saine et comparé à deux formes différentes d’ichtyose12 (peau en écailles de poisson).
Un pH-mètre a été utilisé pour mesurer le pH à la surface, puis la couche cornée a été progressivement enlevée jusqu’à la couche granuleuse à l’aide de ruban adhésif (cette technique est très connue et s’appelle le « scotch-test »). Entre chaque dixième bande de ruban adhésif, le pH a été mesuré et une courbe a pu être établie sur la façon dont le pH change à mesure que l’on s’enfonce dans la couche cornée. On constate ici que pour une peau saine, la courbe passe d’environ 4,5 en surface à environ 7,1 au niveau de la couche granuleuse et qu’à mi-chemin de la couche cornée, le pH est d’environ 5,4 et donc que le changement de pH est plus brutal dans la moitié profonde de la couche cornée, où la structure est également plus compacte. C’est dans cette zone qu’agissent de nombreuses enzymes dépendantes du pH.
D’autres études similaires ont montré que le pH dans les couches les plus externes de la couche cornée est légèrement inférieur à celui de la surface, puis que le pH augmente au fur et à mesure que l’on progresse dans les couches, pour atteindre un pH de 7,0-7,4 lorsque l’on atteint la couche granuleuse.
'Manteau acide'
Ce phénomène, selon lequel la surface de la peau est nettement plus acide que le reste de la peau, est connu sous le nom de « manteau acide ». Ce terme a été inventé en 1928 par deux scientifiques et n’a jamais cessé d’être utilisé depuis, même si le terme « manteau » n’est probablement pas le plus exact. À l’époque, on pensait que le faible pH protégeait contre les infections microbiennes, mais il a été prouvé depuis que ce facteur était beaucoup plus important.
Le manteau acide peut être décrit comme un mélange naturel de différentes substances telles que des acides gras libres, des acides aminés et d’autres petits acides qui maintiennent la surface et les couches extérieures de la couche cornée à un pH relativement bas. Ce point sera décrit plus en détail dans la section suivante. En général, le pH de la surface de la peau se situe entre 4,0 et 6,0 – à quelques exceptions près qui ont un pH plus élevé.
Dans la littérature scientifique, un certain nombre de valeurs de pH différentes sont considérées comme normales, mais lors de la comparaison, il faut savoir où la mesure a été prise sur le corps et quelle méthode de mesure a été utilisée.
Une étude intéressante de 2006 a montré que si l’on s’abstenait d’appliquer quoi que ce soit sur la peau de l’intérieur de l’avant-bras pendant 24 heures, le pH chutait en moyenne de 5,12 ± 0,56 à 4,93 ± 0,45. Il a été estimé que le pH « naturel » de la peau dans cette zone serait en moyenne de 4,7.
L’étude a également montré qu’en général, une peau dont le pH est inférieur à 5,0 est en meilleur état qu’une peau dont le pH est supérieur à 5,0 ; cela a été démontré par la mesure de divers paramètres biophysiques tels que la fonction de barrière, le niveau d’hydratation, le niveau de squames et la résistance à l’irritation induite (par exemple en utilisant du laurylsulfate de sodium, une substance irritante pour la peau). Il a également été observé que le microbiote « normal » adhérait mieux à la peau dont le pH était relativement bas.
Il a été démontré que le pH relativement bas de la surface de la peau et le gradient de pH à travers la couche cornée ont de nombreuses fonctions importantes et souvent interdépendantes pour la peau, qui seront décrites ici :
- Activité enzymatique : l’activité de nombreuses enzymes dépend du pH. Cela vaut à la fois pour certaines enzymes qui contribuent à la constitution des barrières cutanées et pour les enzymes qui contribuent à la dégradation des cornéodesmosomes et favorisent ainsi la desquamation (il doit y avoir un équilibre).
Deux enzymes clés pour la formation de céramides importantes pour la barrière cutanée dépendent du pH : la β-glucocérébrosidase a un pH optimal de13 5,6 et la sphingomyélinase acide a un pH optimal à 4,5. Si le pH est nettement supérieur ou inférieur à ces valeurs, les activités enzymatiques sont réduites et moins de céramides sont formées.
Les autres enzymes dépendantes du pH comprennent les phosphatases, les phospholipases et le groupe d’enzymes protéases à sérine, qui comprend les enzymes kallikréines.
Les protéases à sérine sont des enzymes qui brisent les liaisons peptidiques dans les protéines – notamment dans les protéines qui composent les cornéodesmosomes qui relient les cornéocytes entre eux, ce qui peut nuire à l’intégrité et à la cohésion de la peau.
D’autres protéases à sérine peuvent inactiver les enzymes de transformation des lipides, inhiber l’excrétion des corps lamellaires et stimuler l’hyperprolifération épidermique (qui est un facteur d’acné par exemple). Ces protéases à sérine ont un pH optimal légèrement plus élevé (pour beaucoup d’entre elles, autour de pH 7).
Ainsi, si le pH de la peau augmente, ces enzymes sont plus actives et, dans le même temps, les deux enzymes clés pour la formation des céramides sont moins actives.
Un pH élevé peut donc inhiber les fonctions de barrière de la peau, ce qui constitue la deuxième raison pour laquelle le manteau acide de la peau est important.
- Maintien de la barrière cutanée : les fonctions de barrière de la peau, extrêmement importantes, peuvent être classées en différents systèmes interconnectés : la barrière physique, la barrière chimique, la barrière microbienne et la barrière immunitaire.
Ensemble, elles assurent la protection physique, chimique et biologique de l’organisme contre les agents extérieurs. La barrière physico-chimique veille également à ce que le corps ne perde pas trop d’eau, par exemple.
La barrière de perméabilité physique, qui est également importante pour la protection chimique et biologique, est principalement constituée des composants de la couche cornée sous la forme de cornéocytes hydrophiles, des substances qui les maintiennent ensemble et de la matrice lipophile intercellulaire organisée.
Comme indiqué plus haut, le pH de la peau est crucial pour plusieurs éléments des fonctions de barrière : excrétion par les corps lamellaires d’enzymes, de lipides et de substances antimicrobiennes ; ainsi que le niveau d’activité des enzymes qui assurent le métabolisme nécessaire à la formation des lipides intercellulaires.
On pense également que le pH est déterminant pour l’organisation des lipides intercellulaires. - ntégrité de la couche cornée – l’équilibre de la desquamation : il existe un équilibre dynamique important entre la cohésion intercellulaire via les cornéodesmosomes et les jonctions serrées et la dégradation naturelle et nécessaire de ces mêmes jonctions, qui aboutit à la desquamation.
Ici aussi, le pH joue un rôle important, notamment en raison de l’activité des enzymes dépendantes du pH, comme décrit plus haut. - Activation des cytokines et inflammation : les cornéocytes de la couche cornée contiennent une réserve de précurseurs de cytokines inflammatoires (Pro-IL1α et proIL-1β). Si la barrière cutanée est perturbée, le pH augmente généralement, ce qui accroît l’activité des protéases à sérine telles que les enzymes kallikréines.
L’activation entraîne la libération et l’activation des cytokines IL-1α et IL-1β, qui déclenchent alors une cascade de réactions contribuant à restaurer la barrière.
Ainsi, une augmentation temporaire du pH aidera à reconstruire la barrière, mais si le pH est trop élevé pendant une période prolongée, cela peut entraîner une inflammation médiée par les cytokines. Inversement, on pense qu’une réduction du pH contribue à réduire l’inflammation. - Le microbiote et la barrière microbienne de la peau : La peau entretient avec le microbiote une relation symbiotique réciproque (où les deux parties tirent profit de la relation) : la peau fournit un environnement propice à certains micro-organismes, qui contribuent à leur tour à la défense microbienne de la peau en empêchant la colonisation d’autres micro-organismes (pathogènes, par exemple) et en aidant la peau d’autres manières.
Le faible pH de la surface de la peau en fait un bon milieu pour le microbiote « normal » et il a également été démontré qu’il inhibe la croissance de certains micro-organismes pathogènes.
En outre, en ce qui concerne la barrière microbienne de la peau, le pH a un impact sur la libération de certaines substances antimicrobiennes telles que les peptides antimicrobiens des corps lamellaires. L’activité de ces derniers – par exemple les peptides antimicrobiens tels que la cathélicidine et la dermicidine, ainsi que les substances cationiques et les nitrates présents dans la sueur – qui dépend également du pH, est optimale à un pH de 5,5.
La conversion en oxyde nitrique de la substance nitrite, produite par les bactéries du microbiote à partir du nitrate présent dans la sueur, ne se produit également qu’à un pH légèrement acide. L’oxyde nitrique remplit un certain nombre de fonctions importantes, non seulement en ce qui concerne l’équilibre microbien de la peau, mais aussi en tant que substance de signalisation intra et extracellulaire qui joue un rôle important dans la cicatrisation des plaies, entre autres.

12L’ichtyose (peau en écailles de poisson) est un terme générique désignant différentes formes de la maladie, qui se manifeste par une peau sèche et squameuse.
13Le pH optimal est la valeur de pH où l’enzyme a l’activité la plus élevée.
Le pH et la peau : mécanismes et facteurs endogènes du pH de la peau
Les mécanismes et substances endogènes qui maintiennent le pH faible à la surface de la peau et le gradient de pH dans la couche cornée sont un sujet complexe. Divers articles scientifiques mettent plus ou moins l’accent sur les différents mécanismes et substances, de sorte qu’il n’est pas tout à fait clair quels sont les plus importants. Il est probable que les différents mécanismes s’influencent mutuellement et que les mécanismes et les substances aient une importance variable dans les différentes couches de la couche cornée.
différentes couches de la couche cornée. En ce qui concerne les substances qui composent le manteau acide et contrôlent le pH dans et sur la couche cornée, on pense que les acides alpha hydroxy (AHA14) tels que l’acide lactique provenant de la sueur et les acides gras du sébum, ainsi que l’acide urocanique (UCA), l’acide pygroglutamique (PCA) et certains acides aminés sont considérés comme la source principale du pH de la couche cornée.
On pense que les acides aminés provenant de la dégradation de la protéine filaggrine et le sulfate de cholestérol ont un certain impact sur le pH dans les couches plus profondes de la couche cornée.
Une autre composante importante de l’acidification des couches profondes de la couche cornée est la protéine de la membrane plasmique, NHE1, située dans la membrane cellulaire des kératinocytes. Il s’agit d’un échangeur Na+/H+ capable de pomper un ion hydrogène (H+) hors de la cellule et de pomper simultanément un ion sodium (Na+) dans la cellule, régulant ainsi le pH à l’intérieur de la cellule et contribuant à réduire le pH dans l’espace intercellulaire (extracellulaire) – plus précisément, on pense que la NHE1 peut former des microdomaines extracellulaires15 dont le pH est relativement bas dans la partie profonde de la couche cornée, à proximité de la couche granuleuse, qui a par ailleurs un pH global d’environ 7,0-7,4.
On suppose que ces microdomaines à pH relativement bas sont importants pour l’activation des enzymes dépendantes du pH qui, comme mentionné ci-dessus, traitent les lipides excrétés par les corps lamellaires et font partie de la matrice lipidique organisée intercellulaire qui crée une barrière.
On pense également que la NHE1 est importante pour la différenciation cellulaire des kératinocytes, par exemple, et qu’elle joue un rôle dans la cicatrisation des plaies en régulant le pH de la surface de la plaie.
Les lipides acidifiants tels que le sulfate de cholestérol et les acides gras libres sont également considérés comme un facteur contribuant au gradient de pH de la couche cornée. Les acides gras libres peuvent être libérés, par exemple, des phospholipides excrétés par les corps lamellaires : ce processus est catalysé par le groupe enzymatique PLA2, qui est un groupe de phospholipases dépendant du pH et dont l’optimum se situe à l’extrémité légèrement acide de l’échelle de pH.
Certains acides aminés et dérivés d’acides aminés ont également un impact sur le pH de la couche cornée. Par exemple, la sueur contient des acides aminés dont une source très importante est la dégradation de la protéine filaggrine.
La dégradation de la filaggrine produit, entre autres, l’acide aminé glutamique, qui peut être converti en acide pyroglutamique (PCA), et l’acide aminé histidine, qui peut être converti en acide urocanique (UCA) par l’intermédiaire de l’enzyme histidase.
Le PCA et l’UCA contribuent tous deux à réduire le pH et sont également hydratants ; ils font partie des facteurs naturels d’hydratation (NMF)16.
En particulier, la voie de transformation de l’acide urocanique-histidine-filaggrine a été étudiée en relation avec son impact sur le pH dans des études animales. Cela suggère que cette dégradation en UCA n’est pas essentielle pour le pH, car d’autres mécanismes compensatoires peuvent prendre le relais et assurer la régulation à la baisse du pH.
Les petits acides tels que l’acide lactique et l’acide butyrique sont également considérés comme régulant à la baisse le pH de la couche cornée. On les trouve, par exemple, dans la sueur provenant des glandes eccrines qui se trouvent presque partout sur le corps. La sueur de ces glandes17 est excrétée directement à la surface de la peau. Elle a un pH compris entre 4,0 et 6,8 et se compose principalement d’eau et de faibles concentrations de petits électrolytes, de petits acides tels que l’acide lactique, l’acide citrique, l’acide ascorbique (vitamine C) et d’urée, ainsi que d’acides aminés et d’acides gras.
La mélanine des mélanosomes de la couche granuleuse contribuerait aussi à la réduction du pH, ce qui expliquerait (en partie) pourquoi les peaux plus pigmentées ont généralement un pH plus faible (environ 0,5 pH de moins).
Enfin, le microbiote peut également contribuer au pH relativement bas de la surface de la couche cornée.

Plusieurs facteurs pour le pH de la peau
De nombreux facteurs endogènes (de l’intérieur) influencent le pH de la peau. Voici les principaux : la zone anatomique de la peau, l’humidité de la peau (une humidité élevée ou faible est associée à une augmentation du pH), le niveau de pigmentation (les peaux plus foncées ont généralement un pH plus faible), le niveau de sébum, le niveau de transpiration, les maladies de la peau, la génétique, l’âge et le sexe – ce dernier point fait l’objet d’un débat. La plupart de ces facteurs seront examinés ci-dessous :
Le pH de la peau varie considérablement d’une zone à l’autre. Si l’on considère l’organisme dans son ensemble, le pH se situe à 95 % entre 4,1 et 5,8, avec une moyenne de 4,9. Les principales zones situées en dehors de cette plage sont des zones semi-fermées et généralement relativement humides telles que les aisselles, l’aine, près des organes génitaux, entre les orteils et dans les plis cutanés, où le pH est généralement plus élevé, de l’ordre de 6,1 à 7,418. Au niveau de l’aisselle, la mesure est comprise entre 5,8 et 7,0. Voici quelques exemples de plages de pH typiques pour différentes zones de la peau chez les adultes ayant une peau normale et saine : front et paupières = 4,7-5,1 ; joues et intérieur de l’avant-bras = 5,1-5,5 ; intérieur de l’avant-bras = 5,1-5,5 ; menton = 5,4-5,7 ; aisselle = 5,8-6,8 ; aine = 6,2-7,1.
L'importance de l'âge
L’âge a un impact relativement important sur le pH de la peau : la peau très jeune et la peau plus âgée ont généralement un pH relativement plus élevé et un pouvoir tampon plus faible. En général, les personnes âgées de 18 à 60 ans présentent un pH relativement stable à la surface de la peau. Les nouveau-nés (non prématurés) ont un pH d’environ 6,0-7,0 et assez uniforme sur toutes les zones de la peau. Le pH de la peau diminue assez brusquement au cours des premiers jours suivant la naissance et de façon plus régulière au cours des premiers mois. Entre 4 et 6 mois, la peau des nourrissons a généralement atteint la plage « normale » des adultes, avec des variations de pH dans les différentes zones de la peau, tout comme chez les adultes. Le pH de la zone des couches est relativement élevé en raison de l’environnement occlusif et humide, ce qui rend la peau plus vulnérable, en particulier chez les bébés portant des couches.
Les personnes âgées de 60 à 70 ans environ présentent généralement une augmentation du pH à la surface de la peau et une réduction du pouvoir tampon de la peau. On pense que l’augmentation du pH chez les personnes âgées est due à une plus faible expression de la NHE1, à une réduction de la conversion des phospholipides en acides gras libres et à une réduction du taux de dégradation de la filaggrine en NMF – dont l’UCA et le PCA. En outre, la production de sébum et de sueur diminue, ce qui réduit encore le pouvoir tampon de la peau et l’apport des acides qu’elle contient. L’augmentation du pH est également liée à une moindre production de lipides épidermiques tels que les céramides, le cholestérol et les acides gras, ainsi qu’à des modifications du microbiote de la peau. Globalement, il en résulte une barrière cutanée moins solide.
Pigmentation et pH de la peau
Comme nous l’avons mentionné, le niveau de pigmentation de la peau affecte également le pH de celle-ci. Il a été démontré que les peaux présentant des niveaux de pigmentation élevés et donc un pH plus faible ont une production lipidique et une densité de corps lamellaires accrues par rapport aux peaux plus claires, ainsi qu’une meilleure intégrité de la couche cornée et une meilleure fonction de barrière, ainsi qu’une reconstruction plus rapide de la barrière, par exemple après un scotch-test ou d’autres formes de lésions cutanées superficielles.
On sait qu’après une rupture de la barrière de perméabilité, il y a une augmentation rapide de la sécrétion des corps lamellaires à partir de la couche granuleuse pour remplacer ce qui a été perdu, et de nouveaux corps lamellaires se forment rapidement. Dans une étude comparant des personnes à la peau claire (niveau I-II sur l’échelle de Fitzpatrick19) à des personnes à la peau plus foncée (niveau IV-V sur l’échelle de Fitzpatrick), il a été observé, entre autres, que si l’on réduit le pH de surface des peaux claires pour qu’il corresponde à celui des peaux foncées à l’aide d’un véhicule contenant de l’acide lactobionique ou du gluconolactone (PHA20), immédiatement après le scotch-test, la vitesse de la reconstruction de la barrière cutanée augmente significativement après 1, 6 et 24 heures, contrairement aux peaux claires traitées avec le même véhicule, mais sans acide lactobionique ni gluconolactone ou le même véhicule avec de l’acide lactobionique neutralisé ou du gluconolactone.
Genre et pH - y a-t-il une corrélation ?
Certaines études suggèrent également que le pH de la peau a une faible corrélation avec le sexe, mais il n’y a pas de consensus clair à ce sujet, certaines études suggérant que les femmes ont un pH le plus bas et d’autres suggérant que ce sont les hommes.
Dans l’ensemble, un certain nombre d’études indiquent que les hommes ont tendance à avoir le pH le plus bas, mais pas significativement plus bas que les femmes.
Les études sur les différences cutanées entre les sexes suggèrent qu’en général, la fonction de barrière cutanée (mesurée en termes de TEWL21) des hommes de moins de 50 ans est meilleure que celle des femmes du même âge, quelle que soit la surface de peau mesurée. Cette différence de barrière cutanée s’atténue avec l’âge.
Le niveau d’hydratation de la couche cornée semble être stable ou augmenter légèrement avec l’âge chez les femmes, alors qu’il diminue à partir de 40 ans environ chez les hommes.
Le pH de la peau présente également un rythme circadien, de sorte que le pH est le plus bas la nuit et le plus élevé l’après-midi, ainsi qu’un rythme annuel, le pH étant généralement légèrement plus bas en hiver qu’en été (la question de savoir s’il s’agit de facteurs endogènes ou exogènes fait l’objet de débats).
14Pour en savoir plus sur les AHA, consultez la description des AHA, BHA et PHA sur ce site.
15Ces microdomaines ne peuvent être mesurés à l’aide d’un pH-mètre à électrode de verre et, par conséquent, le pH de la partie profonde de la couche cornée est le plus souvent mesuré comme étant autour de la neutralité.
16Les NMF sont brièvement décrits dans la description de la glycérine sur ce site Web.
17Il existe également des glandes sudoripares apocrines, qui sont reliées à un follicule pileux. Cette sueur est donc généralement mélangée à du sébum provenant des glandes sébacées, qui ont également une sortie dans le follicule pileux. Les glandes sudoripares apocrines se trouvent principalement au niveau des aisselles et des organes génitaux. Leurs sécrétions ont un pH compris entre 6,0 et 7,5 et sont composées d’eau, de protéines, d’hydrates de carbone, de certains déchets de l’organisme, de lipides et de stérols. Il s’agit d’un liquide relativement visqueux qui est intrinsèquement inodore, mais certaines de ces substances sont décomposées par des micro-organismes présents sur la peau et les métabolites qui en résultent produisent l’odeur de sueur.
18En raison du pH relativement élevé de l’aisselle, par exemple, le microbiote y est différent, ce qui contribue à l’odeur de sueur qui se forme à partir du métabolisme des sécrétions des glandes apocrines.
19L’échelle de Fitzpatrick est une échelle de I à VI qui indique le degré de pigmentation de la peau et la façon dont elle réagit aux UV.
20PHA est l’acronyme de Poly Hydroxy Acid. Pour en savoir plus sur les PHA, consultez la description des AHA, BHA et PHA sur ce site.
21TEWL est le sigle de Trans Epidermal Water Loss (perte d’eau transépidermique).
Le pH et la peau : facteurs exogènes du pH de la peau
Les facteurs exogènes (externes) comprennent l’occlusion de la peau (par exemple avec des gants), le microbiote de la peau (dont on peut dire qu’il est également influencé par des facteurs endogènes), les facteurs climatiques et les autres substances et produits auxquels la peau est exposée.
L’occlusion de la peau augmente le pH de celle-ci – on le sait depuis les années 1970 – et cela a de nombreuses répercussions.
Il a été démontré qu’après cinq jours d’occlusion de la peau de l’aisselle chez des sujets sains, le pH passait de 4,38 à 7,05, le microbiote cutané se modifiait significativement et la TEWL était multipliée par trois (barrière de perméabilité altérée). Trois jours d’occlusion ont aussi entraîné une augmentation significative du pH, qui n’est revenu à la normale qu’au bout de 24 heures.
Le microbiote cutané agit sur le pH de la peau – par la formation de métabolites – et est influencé par celui-ci. Il existe donc une interaction relativement complexe entre la peau et le microbiote de la peau, qui fait l’objet de nombreuses recherches.
Bien entendu, les produits appliqués sur la peau peuvent également affecter le pH de surface de la peau et, dans certains cas, son pouvoir tampon. Par exemple, un savon classique au pH élevé peut augmenter le pH de la peau, et les produits qui restent sur la peau (produits sans rinçage) peuvent également affecter le pH et le pouvoir tampon – dans les deux sens.
L’eau du robinet peut également affecter le pH de la peau. En Europe, le pH de l’eau varie de façon relativement importante. Par exemple, au Danemark, il se situe entre 6,5 et 8,0, tandis que le pH des nappes phréatiques est généralement plus faible au nord et plus élevé au sud de l’Europe, mais reste compris entre 5,5 et 8,5.
Des études ont montré qu’un simple lavage de la peau à l’eau du robinet peut augmenter le pH de surface de la peau pendant environ 4 heures.
Le pH et la peau : le pouvoir tampon de la peau
Comme nous l’avons mentionné, le pouvoir tampon d’un système est sa capacité à résister à des fluctuations importantes du pH en dépit des influences extérieures.
Il a été constaté que la peau a un assez bon pouvoir tampon entre les pH 4 et 8. On pense que ce pouvoir tampon provient de différents systèmes tampons présents dans la peau et on ne sait pas encore lesquels y contribuent le plus.
Des études suggèrent que les composants de la sueur contribuent au pouvoir tampon et certaines études indiquent que les systèmes de tampon acide lactique/lactate et acide carbonique/bicarbonate y contribuent.
L’acide lactique présent dans la sueur a un pKa de 3,8, ce qui est inférieur au pH de la couche cornée. Des études récentes suggèrent que le système tampon acide lactique/lactate n’est pas le principal système tampon de la couche cornée. Le système tampon acide carbonique/bicarbonate ne semble pas non plus jouer un rôle important dans le système tampon de la peau.
Des études plus anciennes ont émis l’hypothèse que le sébum contribue au pouvoir tampon en protégeant l’épiderme des acides et des bases externes, simplement en inhibant la pénétration dans la peau et donc l’impact que les substances externes peuvent avoir. Cette hypothèse est considérée comme correcte.
On pensait également que les acides gras contenus dans le sébum contribuaient au pouvoir tampon, mais on estime aujourd’hui que cette part est négligeable. La kératine a également été considérée comme un composant possible du pouvoir tampon, mais il n’y a pas encore de preuves à ce sujet.
Des études récentes suggèrent que ce sont principalement les acides aminés qui assurent le pouvoir tampon de la peau.
On ne sait pas encore exactement quels acides aminés sont impliqués, mais il pourrait s’agir d’acides aminés présents dans la sueur provenant des glandes sudoripares eccrines. Cette sueur contient environ 0,05 % d’acides aminés. Il peut également s’agir d’acides aminés provenant de la dégradation des protéines de la peau, telles que les desmosomes et la filaggrine, et des follicules pileux.

Il ne fait aucun doute que la peau normale et saine possède un pouvoir tampon raisonnablement bon dans la plage de pH normale de la peau, mais des études supplémentaires sont nécessaires pour élucider les systèmes tampons qui contribuent le plus à ce pouvoir tampon.
Le pH et la peau : problèmes et maladies de peau
Un certain nombre de problèmes cutanés, de cicatrisation et de maladies de la peau sont associés à un pH élevé dans la couche cornée. Pour les maladies de la peau qui ont été étudiées en particulier, il n’est pas clair si c’est la maladie qui entraîne l’augmentation du pH ou si c’est l’augmentation du pH qui contribue au développement de la maladie.
De nombreux problèmes de peau sont associés à une inflammation de la peau et, en général, cette inflammation entraîne une augmentation du pH. Les peaux sèches et sensibles sont également souvent associées à un pH de surface légèrement plus élevé.
En général, une barrière cutanée compromise est souvent associée à des problèmes de peau et, comme vous pouvez le constater, le pH joue un rôle majeur dans la fonction et le maintien de la barrière cutanée. Plusieurs études ont examiné si la réduction du pH de surface pouvait apaiser et améliorer l’état de la peau. Les paragraphes suivants présentent plusieurs problèmes cutanés pertinents et les études qui y sont associées.
L’ichtyose
L’ichtyose (peau en écailles de poisson) est un groupe de maladies caractérisées par une peau sèche et squameuse avec un pH de surface élevé. Elle est associée à une réduction de la filaggrine fonctionnelle (due à une mutation du gène de la filaggrine), qui est un composant très important dans la structure de la couche cornée, l’organisation de la matrice lipophile intercellulaire et, surtout, le niveau d’hydratation important de la peau, en donnant naissance à plusieurs des composants des NMF. L’augmentation du pH empêche le processus de desquamation de fonctionner comme il le devrait.
Psoriasis
Comme l’ichtyose, le psoriasis est une maladie de peau héréditaire caractérisée par une éruption cutanée limitée et squameuse, souvent associée à une légère augmentation du pH de la surface de la peau. Cette maladie est généralement très bien documentée, mais le rôle du pH dans le psoriasis n’a pas fait l’objet d’autant d’écrits. On sait que les changements dans la différenciation des cellules de la peau, la barrière cutanée et l’inflammation jouent un rôle crucial dans la pathogenèse du psoriasis et l’on pense donc que le pH est également un facteur.
L'intertrigo
L’intertrigo à candida est une infection fongique – généralement là où deux zones de peau se touchent – qui se manifeste par une peau brillante, rouge et qui démange. Certaines études ont montré une corrélation avec un pH élevé à la surface de la peau. Cette maladie est également associée au diabète et à la dialyse.
Lors d’une expérience sur des sujets sains, une solution du champignon Candica albicans dans une solution tampon de pH 6 ou 4,5 a été appliquée sur une peau saine sous occlusion, ce qui, après 24 heures, a montré que ce champignon ne se comportait pas aussi bien dans l’environnement acide. Il a été démontré qu’un pH élevé augmentait le risque de cette infection fongique.
L'acné
L’acné est associée à une inflammation de la peau, à une croissance accrue de certaines souches de Cutibacterium acnes (anciennement dénommé : Propionibacterium acnes) et à une augmentation du pH à la surface de la peau.
Dans une étude portant sur 200 patients atteints d’acné et 200 personnes sans acné (réparties également entre hommes et femmes âgés de 15 à 30 ans), le pH a été mesuré sur le front, le nez, les joues et le menton, ce qui a révélé une différence significative : en moyenne, le pH des personnes sans acné était de 5,09 ± 0,39, tandis que celui des patients acnéiques était de 6,35 ± 1,3. On pense que le pH plus élevé est favorable à la croissance de la bactérie Cutibacterium acnes.
Ulcéres
Les ulcères sont également associés à une augmentation du pH. Les plaies ouvertes ont un pH compris entre 6,5 et 8,5, tandis que les plaies chroniques problématiques ont un pH compris entre 7,2 et 8,9. La cicatrisation des plaies est un processus complexe et le pH de la surface change au cours du processus de cicatrisation.
Au cours la de cicatrisation, le pH doit diminuer pour qu’un certain nombre de processus importants puissent avoir lieu, tels que la prolifération des fibroblastes, la formation de collagène, l’activité des macrophages et la différenciation des kératinocytes.
Une étude a cherché à savoir si le pH pouvait être un outil de diagnostic du processus de cicatrisation des plaies et aider ainsi à évaluer le type de traitement dont une plaie a besoin, comme des antibiotiques (en cas d’infection bactérienne de la plaie). On n’en est pas encore là, mais des études ont montré que certaines souches de bactéries responsables d’infections de plaies avaient davantage tendance à former un biofilm22 en présence d’un pH plus élevé. Il a également été constaté que, dans certaines situations, le traitement des plaies avec un produit topique23 à faible pH peut avoir un effet positif sur la cicatrisation des plaies, probablement en augmentant, par exemple, l’activité antimicrobienne de certaines substances à la surface de la peau et en régulant l’activité de certaines enzymes.

L'eczéma
L’eczéma, comme la dermatite atopique, la dermatite de contact et l’érythème fessier, est associé à une inflammation de la peau et à un pH élevé.
La dermatite atopique s’accompagne souvent d’une réduction de la filaggrine active, qui, comme nous l’avons vu plus haut, joue un rôle important dans la barrière cutanée, l’hydratation et le pH de la peau. Dans la zone des couches, la peau a généralement un pH élevé, ce qui peut contribuer à l’activation des enzymes protéase et lipase et ainsi altérer la barrière cutanée, ce qui contribue au développement de l’eczéma.
En ce qui concerne la dermatite atopique, des modèles murins de la maladie ont été étudiés en particulier. Par exemple, il a été étudié si un traitement avec des produits topiques ayant un pH relativement bas (par exemple avec de l’acide lactobionique, un PHA) est capable d’atténuer les symptômes, et les études suggèrent que c’est le cas.
Il est généralement admis que le maintien d’un pH cutané normal grâce à des produits topiques appropriés peut améliorer l’état de la peau. Certaines études suggèrent même que le maintien d’une couche cornée légèrement acide peut inhiber le développement de la dermatite atopique. Des études similaires ont également été menées sur la peau de nouveau-nés et de personnes âgées ainsi que sur des rats. Elles ont montré que l’utilisation topique de produits à pH relativement bas contenant par exemple des PHA ou des AHA peut normaliser le pH et la fonction de barrière de la peau.
Dans une étude sur des personnes ayant une peau légèrement sèche, un produit de pH 3,7-4,0 contenant 4 % d’acide lactique (un AHA) a été appliqué deux fois par jour pendant 4 semaines. Il en résulte une amélioration significative de la concentration en céramides de la couche cornée, de la fonction de barrière et une réduction de la sensibilité à l’irritation induite par le laurylsulfate de sodium. Quant à la durée d’action d’un produit à pH bas sur la peau, elle dépend à la fois de la composition et du pouvoir tampon du produit et de l’état de la peau.
Dans une étude humaine contrôlée par véhicule, ce phénomène a été étudié en utilisant une crème contenant de l’acide acétique ou du chlorure d’hydrogène à un pH de 3,5. Il a été constaté que juste après l’application, le pH chutait immédiatement et qu’il remontait après 15 minutes, mais lentement, et qu’un pH relativement bas persistait jusqu’à 6 heures après l’application.
22Le biofilm est une fine pellicule de bactéries intégrée dans une matrice spéciale produite par les bactéries elles-mêmes. Les biofilms sont présents dans de nombreux endroits et peuvent poser des problèmes lorsqu’ils se trouvent dans une plaie, par exemple, car ils rendent les bactéries plus résistantes à différentes interventions, telles qu’un pH élevé ou faible et des antibiotiques.
23L’utilisation topique désigne l’application du produit sur des surfaces corporelles : tous les cosmétiques sont donc utilisés par voie topique.
pH et produits topiques
Les produits que vous utilisez sur votre peau peuvent affecter naturellement le pH de votre peau de manière plus ou moins importante. Comme indiqué plus haut, c’est souvent un pH trop élevé qui est associé aux problèmes cutanés. De nombreuses études ont donc cherché à savoir si les produits topiques sans rinçage pouvaient réduire le pH de la peau et ainsi améliorer la barrière cutanée – et de nombreuses études montrent que c’est le cas.
De même, de nombreuses études ont examiné la manière dont différents types de produits affectent le pH de la peau, en particulier les nettoyants, car certains d’entre eux peuvent en augmenter le pH. Dans ce contexte, il est important de se rappeler que la peau a généralement un assez bon pouvoir tampon et qu’elle normalisera donc son pH après un certain temps, et que l’impact des produits sur la peau peut être complexe et dépend de la composition exacte du produit et de la manière dont il est utilisé, sans parler de l’état de la peau. Ce n’est donc pas seulement le pH du produit qui détermine son impact sur le pH de la peau.
Le pouvoir tampon du produit est également un facteur important, rarement connu et rarement étudié dans les études portant sur l’influence des produits sur le pH de la peau. Les études qui ont été menées sont rarement faciles à comparer, car il existe de nombreuses variations : par exemple, la méthode d’essai, la peau des sujets testés, après combien de temps après l’application la mesure du pH est effectuée, etc. Il convient également de noter que le pH de la peau après l’application d’un produit résulte à la fois du pH du produit et de la peau, ainsi que du pouvoir tampon du produit et de la peau.
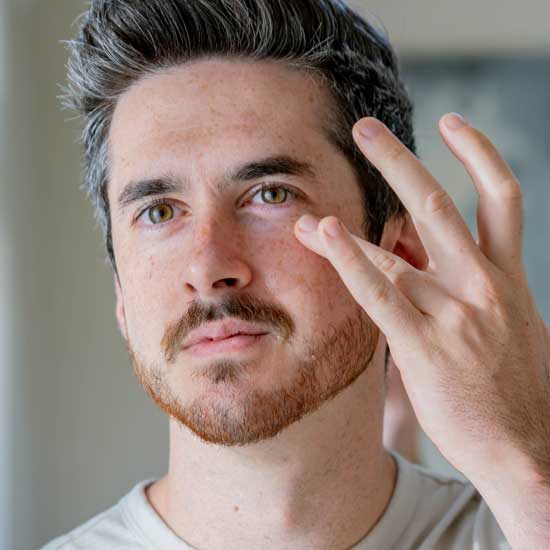
Les nettoyants
Les nettoyants constituent un vaste groupe de types de produits très différents qui peuvent affecter la peau de plusieurs manières : la plupart d’entre eux augmentent le pH de la peau – c’est le cas de beaucoup d’entre eux, parce qu’ils doivent être éliminés avec de l’eau (produits à rincer) et, comme mentionné, l’eau elle-même peut augmenter le pH de la peau, mais généralement pas très longtemps – probablement parce que l’eau n’a pratiquement pas de pouvoir tampon.
Le savon classique, utilisé depuis plus de mille ans, contient des tensioactifs d’origine naturelle (souvent appelés également détergents ou surfactants), qui sont produits par la réaction de saponification des graisses, est généralement alcalin avec un pH compris entre 8,0 et 11,0 : il n’est donc pas surprenant qu’ils puissent augmenter le pH de la peau.
Des études menées sur ces savons classiques ont montré que le pH de la peau augmente généralement d’environ 2 unités et ne revient pas à la normale dans les 6 heures.
Par rapport à l’utilisation d’eau uniquement pour laver la peau, le savon classique prolonge le temps nécessaire pour que la peau retrouve son niveau de pH normal et, comme beaucoup d’autres nettoyants, le savon classique peut éliminer une grande partie des huiles solubles de la peau, ce qui rendrait celle-ci plus vulnérable et sujette à des irritations.
Des études ont montré que l’ajout de lipides aux produits nettoyants peut réduire l’interaction entre les agents tensioactifs du nettoyant et les lipides présents sur la peau, réduisant ainsi cet effet.
Détergents synthétiques
Vers 1950, un nouveau type d’agent tensioactif appelé « syndet », abréviation de détergent synthétique, a été inventé et, depuis lors, ont suivi de nombreux autres surfactants plus doux et plus naturels – par rapport aux syndets.
Ces agents tensioactifs peuvent être utilisés pour fabriquer des produits nettoyants dont le pH correspond à celui de la peau. Ils sont souvent présentés comme étant beaucoup plus doux pour la peau (ce qui est souvent le cas) que le savon solide classique. Mais il est important d’examiner la totalité de la composition chimique de ces produits et ce qu’ils peuvent faire à la peau au-delà de la modification du pH.
Une étude de 2014 a tenté de comparer la peau de l’intérieur de l’avant-bras de deux groupes de personnes en bonne santé qui avaient utilisé pendant plus de 5 ans soit un savon solide classique au pH élevé, soit un produit nettoyant au pH relativement proche de celui de la peau. Il a été constaté que l’utilisation d’un savon solide classique à pH élevé n’affectait pas la capacité de régulation du pH de la peau : les mécanismes tampons. Il a également été constaté que le pH de la peau augmentait de manière presque égale avec les deux produits et que, pour les deux groupes, le pH de la peau revenait à la normale au bout d’environ 6 heures.
Le pH détermine-t-il si un produit est doux ou non ?
Une autre étude intéressante s’est penchée sur l’affirmation selon laquelle les nettoyants dont le pH est proche de celui de la peau sont meilleurs pour la peau.
Dans cette étude, une série de mesures a été effectuée sur la peau des aisselles d’un groupe de personnes en bonne santé après l’utilisation de divers produits nettoyants sous forme de barres « syndet » et de quelques savons liquides dont la composition est connue (certains d’entre eux seulement qualitativement) et le pH connu – tous à base principalement de surfactants anioniques24 , qui sont utilisés dans la grande majorité des produits nettoyants aujourd’hui.
La sécheresse de la peau et la barrière cutanée (mesure TEWL) ont notamment été analysées. Cette étude a montré que l’utilisation d’un nettoyant principalement à base de tensioactifs anioniques (chargés négativement) avec un pH proche de celui de la peau augmentait davantage les niveaux de sécheresse et d’irritation de la peau que la même formulation ajustée à un pH de 7,0. L’explication possible est une interaction électrostatique accrue (les ions chargés négativement interagissent avec les ions chargés positivement) entre les agents de surface anioniques contenus dans le produit nettoyant et la couche cornée à bas pH par rapport à un pH neutre.
L’explication plus approfondie et technique est la suivante : le point isoélectrique de la couche cornée se situe autour de pH 4,0. Au point isoélectrique, la surface de la couche cornée aura un nombre presque égal d’ions chargés positivement et négativement et aura donc une charge nette d’environ 0. À un pH supérieur au point isoélectrique, la surface de la couche cornée aura une prépondérance d’ions chargés négativement et à un pH inférieur au point isoélectrique, il y aura une prépondérance d’ions chargés positivement.
Ainsi, si une solution (nettoyante) dont le pH est supérieur à 4,0 (pH neutre, par exemple) est appliquée sur la peau, il y aura relativement moins d’ions positifs à la surface de la couche cornée avec lesquels les anions (substances chargées négativement) de la solution pourront interagir. Toutefois, si le pH de la solution est plus bas et plus proche ou inférieur au point isoélectrique de la couche cornée, le nombre d’ions chargés positivement sur la couche cornée sera relativement élevé et, par conséquent, le nombre de substances anioniques dans la solution (les surfactants du produit de nettoyage) aura plus d’ions sur la couche cornée pour s’y lier.
Lorsque davantage d’agents tensioactifs se lient à la peau, on peut s’attendre à ce qu’il soit plus difficile de les éliminer complètement en rinçant. Les agents tensioactifs peuvent donc rester plus longtemps sur la peau, ce qui provoque des irritations, un assèchement de la peau et une altération de la barrière cutanée.
La conclusion est que le pH seul ne permet pas de déterminer si un produit est doux ou non : il faut tenir compte de la totalité de la composition du produit et de l’interaction entre les substances utilisées dans le produit et la couche cornée à ce pH.
Odeur de sueur, déodorants et pH
Le fait que les produits puissent affecter le pH de la peau est intéressant en ce qui concerne les déodorants et l’odeur de sueur souvent indésirable des aisselles. Le pH plus élevé des aisselles est l’une des raisons pour lesquelles certains micro-organismes s’y développent. Le métabolisme de ces micro-organismes est à l’origine des odeurs de transpiration. On a donc cherché à savoir si les déodorants capables de réduire le pH des aisselles pouvaient également réduire les odeurs.
Les résultats d’une étude ont montré que l’utilisation quotidienne de certains déodorants ayant un pH de 5,0 réduisait le pH de la peau de l’aisselle pendant au moins 2 à 4 heures ainsi que l’odeur de la sueur. Le pH revenait à son niveau initial deux jours après la dernière application.
Bénéfique pour la peau
La réduction du pH de la peau et l’utilisation généralisée de produits sans rinçage dont le pH est proche de celui de la peau sont également intéressantes dans d’autres contextes, notamment pour les peaux âgées et les peaux atteintes de dermatite atopique. Par exemple, certaines études montrent que les peaux âgées, qui ont généralement un pH légèrement plus élevé et une barrière cutanée plus fragile, bénéficient de l’application de produits dont le pH n’est pas trop élevé.
Des études suggèrent que l’effet ne se produit qu’après une utilisation quotidienne prolongée. L’une de ces études a porté sur 20 personnes âgées d’une soixantaine d’années qui ont utilisé soit une émulsion spécifique ajustée à un pH de 4,0, ou un pH de 5,8. Après 4 semaines, le pH de la peau était significativement réduit lorsque le produit au pH 4,0 avait été utilisé, tandis que les résultats concernant les niveaux d’hydratation de la peau et la perte d’eau cutanée n’étaient pas significativement différents pour les deux émulsions.
Les deux émulsions ont augmenté la teneur totale en lipides de la peau, le produit au pH 4,0 étant légèrement plus efficace à cet égard. Après les 4 semaines, la peau a été soumise à un test avec la substance irritante laurylsulfate de sodium. Ce test a montré que la peau traitée avec l’émulsion au pH 4.0 était plus résistante.
Une métaétude sur le soulagement de la peau sèche, les démangeaisons et l’amélioration générale de la barrière cutanée a montré qu’en général, les produits sans rinçage ayant un pH de 4,0 peuvent améliorer la barrière cutanée des peaux âgées. En outre, le traitement de la dermatite atopique à l’aide de produits sans rinçage à pH relativement bas semble avoir un effet bénéfique. En général, la normalisation du pH de la peau par des produits topiques peut, dans certains cas, contribuer à établir un microbiote plus équilibré, à améliorer la barrière cutanée, à induire une différenciation épidermique et à réduire l’inflammation de la peau.
24Une molécule anionique a une charge négative, une molécule cationique a une charge positive, une molécule amphotère a une charge à la fois positive et négative et une molécule non ionique n’a pas de charge.
Variation du pH dans le lot
Les différents types de produits sont souvent fabriqués dans des plages de pH différentes. Il n’existe pas de règles spécifiques sur le pH que doit avoir un produit cosmétique, ni sur la variation du pH d’un produit donné d’un lot à l’autre. Les fabricants de produits destinés à des zones particulièrement sensibles, telles que le contour des yeux et le vagin, choisissent généralement un pH proche du pH normal de la zone concernée. Bien entendu, les produits cosmétiques doivent pouvoir être utilisés en toute sécurité.
C’est pourquoi les valeurs de pH très basses et très élevées sont généralement réservées à des types de produits spécifiques (par exemple, certains produits de lissage des cheveux ont un pH très élevé). Le pH d’un produit peut varier légèrement d’un lot à l’autre pour plusieurs raisons. Par exemple, les matières premières utilisées peuvent présenter des variations de pH et la méthode de production peut rendre difficile le réajustement du pH (par exemple, si un produit doit être versé dans l’emballage à chaud). Tous les fabricants ne réajustent pas le pH (après avoir mélangé toutes les autres matières premières), par exemple dans le cas de produits qui ne sont pas particulièrement sensibles à la variation du pH en termes d’efficacité et de stabilité et/ou lorsque le fabricant a constaté que le pH de la formulation ne varie généralement pas beaucoup d’un lot à l’autre. En général, les fabricants de cosmétiques veillent à ce que le pH d’un produit donné se situe dans une fourchette relativement étroite : entre 0,5 et 1 unité de pH.
Il en va de même pour PUCA – PURE & CARE, et l’on utilise dans la plupart des produits l’acide citrique et la base hydroxyde de sodium pour réajuster le pH des produits aqueux.

Sources
- Ali, S. M.; & Yosipovitch, G. Skin pH: from basic science to basic skin care. Acta dermato-venereologica, 2013, 93(3), 261–267.
- Behne, M. J.; Meyer, J. W.; Hanson, K. M.; Barry, N. P.; Murata, S.; Crumrine, D.; Clegg, R. W.; Gratton, E.; Holleran, W. M.; Elias, P. M.; & Mauro, T. M. NHE1 regulates the stratum corneum permeability barrier homeostasis. Microenvironment acidification assessed with fluorescence lifetime imaging. The Journal of biological chemistry, 2002, 277(49), 47399–47406.
- Bennison, L.; Miller, C.; Summers, R.H.; Minnis, A.; Sussman, G.; & McGuiness, W.J. The pH of wounds during healing and infection: A descriptive literature review. Wound Practice & Research: Journal of the Australian Wound Management Association, 2017, 25, 63.
- Buck, R.; Rondinini, S.;Covington, A. ; Baucke, F. ; Brett, C. ; Camoes, M. ; Milton, M. ; Mussini, T. ; Naumann, R. ; Pratt, K. ; Spitzer, P. & Wilson, G. Measurement of pH. Definition, standards, and procedures (IUPAC Recommendations 2002). Pure and Applied Chemistry, 2002, 74(11), 2169-2200.
- Elias, P.M. Stratum corneum acidification: how and why?. Experimantal Dermatol, 2015, 24: 179-180.
- Feingold K. R. Lamellar bodies: the key to cutaneous barrier function. The Journal of investigative dermatology, 2012, 132(8), 1951–1953.
- Fluhr, J. W.; Elias, P. M.; Man, M. Q.; Hupe, M.; Selden, C.; Sundberg, J. P.; Tschachler, E.; Eckhart, L.; Mauro, T. M.; & Feingold, K. R. Is the filaggrin-histidine-urocanic acid pathway essential for stratum corneum acidification?. The Journal of investigative dermatology, 2010, 130(8), 2141–2144.
- Francl; M. Urban legends of chemistry. Nature Chemistry, 2010; 2, 600–601.
- Fürtjes, T.; Weiss, K. T.; Filbry, A.; Rippke, F.; & Schreml, S. Impact of a pH 5 Oil-in-Water Emulsion on Skin Surface pH. Skin pharmacology and physiology, 2017, 30(6), 292–297.
- Gunathilake, R.; Schurer, N. Y.; Shoo, B. A.; Celli, A.; Hachem, J. P.; Crumrine, D.; Sirimanna, G.; Feingold, K. R.; Mauro, T. M.; & Elias, P. M. pH-regulated mechanisms account for pigment-type differences in epidermal barrier function. The Journal of investigative dermatology, 2009, 129(7), 1719–1729.
- Hachem, J. P.; Crumrine, D.; Fluhr, J.; Brown, B. E.; Feingold, K. R.; & Elias, P. M. pH directly regulates epidermal permeability barrier homeostasis, and stratum corneum integrity/cohesion. The Journal of investigative dermatology, 2003, 121(2), 345–353.
- Hatano, Y.; Man, M. Q.; Uchida, Y.; Crumrine, D.; Scharschmidt, T. C.; Kim, E. G.; Mauro, T. M.; Feingold, K. R.; Elias, P. M.; & Holleran, W. M. Maintenance of an acidic stratum corneum prevents emergence of murine atopic dermatitis. The Journal of investigative dermatology, 2009, 129(7), 1824–1835.
- Hawkins, S.; Dasgupta, B. R.; & Ananthapadmanabhan, K. P. Role of pH in skin cleansing. International journal of cosmetic science, 2021, 43(4), 474–483.
- Hyldebrandt, S. pH-skalaen fylder 100 år: pH-skalaen fylder 100 år (videnskab.dk). 2009. Lokaliseret 2. Juni 2023.
- Kezic, S.; & Jakasa, I. Filaggrin and Skin Barrier Function. Current problems in dermatology, 2016, 49, 1–7.
- Knox, S.; & O'Boyle, N. M. Skin lipids in health and disease: A review. Chemistry and physics of lipids. 2021; 236, 105055.
- Korting, H. C.; & Braun-Falco, O. The effect of detergents on skin pH and its consequences. Clinics in dermatology, 1996, 14(1), 23–27.
- Kumar, P.; & Das, A. Acid mantle: What we need to know. Indian journal of dermatology, venereology and leprology, 2023, 1–4.
- Lambers, H.; Piessens, S.; Bloem, A.; Pronk, H.; & Finkel, P. Natural skin surface pH is on average below 5, which is beneficial for its resident flora. International journal of cosmetic science, 2006, 28(5), 359–370.
- Lee, N. R.; Lee, H. J.; Yoon, N. Y.; Kim, D.; Jung, M. ; & Choi, E. H. Application of Topical Acids Improves Atopic Dermatitis in Murine Model by Enhancement of Skin Barrier Functions Regardless of the Origin of Acids. Annals of dermatology, 2016, 28(6), 690–696.
- Levin, J.; & Maibach, H. Human skin buffering capacity: an overview. Skin research and technology: official journal of International Society for Bioengineering and the Skin (ISBS) [and] International Society for Digital Imaging of Skin (ISDIS) [and] International Society for Skin Imaging (ISSI), 2008, 14(2), 121–126.
- Lichterfeld-Kottner, A.; El Genedy, M.; Lahmann, N.; Blume-Peytavi, U.; Büscher, A.; & Kottner, J. Maintaining skin integrity in the aged: A systematic review. International journal of nursing studies, 2020, 103, 103509.
- Luebberding, S.; Krueger, N.; & Kerscher, M. Skin physiology in men and women: in vivo evaluation of 300 people including TEWL, SC hydration, sebum content and skin surface pH. International journal of cosmetic science, 2013, 35(5), 477–483.
- Lukić, M.; Pantelić, I.; & Savić, S.D. Towards Optimal pH of the Skin and Topical Formulations: From the Current State of the Art to Tailored Products. Cosmetics, 2021; 8(3):69.
- Man, M. Q.; Xin, S. J.; Song, S. P.; Cho, S. Y.; Zhang, X. J.; Tu, C. X.; Feingold, K. R.; & Elias, P. M. Variation of skin surface pH, sebum content and stratum corneum hydration with age and gender in a large Chinese population. Skin pharmacology and physiology, 2009, 22(4), 190–199.
- Ohman, H.; & Vahlquist, A. The pH gradient over the stratum corneum differs in X-linked recessive and autosomal dominant ichthyosis: a clue to the molecular origin of the "acid skin mantle"?. The Journal of investigative dermatology, 1998, 111(4), 674–677.
- Panther, D. J.; & Jacob, S. E. The Importance of Acidification in Atopic Eczema: An Underexplored Avenue for Treatment. Journal of clinical medicine, 2015, 4(5), 970–978.
- pH of the Skin: Issues and Challenges. Redigeret af: Christian Surber, Howard Maibach & Christoph Abels. Udgivet af S. Karger AG, 2018.
- Prakash, C.; Bhargava, P.; Tiwari, S.; Majumdar, B.; & Bhargava, R. K. Skin Surface pH in Acne Vulgaris: Insights from an Observational Study and Review of the Literature. The Journal of clinical and aesthetic dermatology, 2017, 10(7), 33–39.
- Proksch E. pH in nature, humans and skin. The Journal of dermatology, 2018, 45(9), 1044–1052.
- Rippke, F.; Schreiner, V.; & Schwanitz, HJ. The Acidic Milieu of the Horny Layer. American Journal of Clinical Dermatology, 2002, 3, 261–272.
- Schmid-Wendtner, M. H.; & Korting, H. C. The pH of the skin surface and its impact on the barrier function. Skin pharmacology and physiology, 2006, 19(6), 296–302.
- Schreml, S.; Kemper, M.; & Abels, C. Skin pH in the Elderly and Appropriate Skin Care. EMJ Dermatology, 2014, 2[1], 86-94.
- Stenzaly-Achtert, S.; Schölermann, A.; Schreiber, J.; Diec, K. H. ; Rippke, F. ; & Bielfeldt, S. Axillary pH and influence of deodorants. Skin research and technology: official journal of International Society for Bioengineering and the Skin (ISBS) [and] International Society for Digital Imaging of Skin (ISDIS) [and] International Society for Skin Imaging (ISSI), 2000, 6(2), 87–91.
- Takagi, Y.; Kaneda, K.; Miyaki, M.; Matsuo, K.; Kawada, H.; & Hosokawa, H. The long-term use of soap does not affect the pH-maintenance mechanism of human skin. Skin research and technology: official journal of International Society for Bioengineering and the Skin (ISBS) [and] International Society for Digital Imaging of Skin (ISDIS) [and] International Society for Skin Imaging (ISSI), 2015, 21(2), 144–148.
- van Smeden, J.; & Bouwstra, J. A. Stratum Corneum Lipids: Their Role for the Skin Barrier Function in Healthy Subjects and Atopic Dermatitis Patients. Current problems in dermatology, 2016, 49, 8–26.
- Website ved Buhl-Bonsoe: pH måler: Hvad er pH-værdi? pH måling | Få udstyr af god kvalitet her | Buhl & Bønsøe (buhl-bonsoe.dk). Lokaliseret 8. Juni 2023.
- Wikipedia websites: pH: pH - Wikipedia; Acid dissociation constant: Acid dissociation constant - Wikipedia; Henderson–Hasselbalch equation: Henderson–Hasselbalch equation - Wikipedia; Sweat gland: Sweat gland - Wikipedia. Lokaliseret 8. Juni 2023.
- Yosipovitch, G.; Maayan-Metzger, A.; Merlob, P.; & Sirota, L. Skin barrier properties in different body areas in neonates. Pediatrics, 2000, 106(1 Pt 1), 105–108.
- Yousef, H.; Alhajj, M.; Sharma, S. Anatomy, Skin (Integument), Epidermis. Opdateret November 2022 i StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; Juni 2023.
- Zulkarnay, Z.; Shazwani, S.; Ibrahim, B.; Jurimah, A. J.; Ruzairi A. R.; & Zaridah, S. An Overview on pH Measurement Technique and Application in Biomedical and Industrial Process. 2015, 2nd International Conference on Biomedical Engineering (ICoBE), Penang, Malaysia, March 2015, pp. 1-6.
